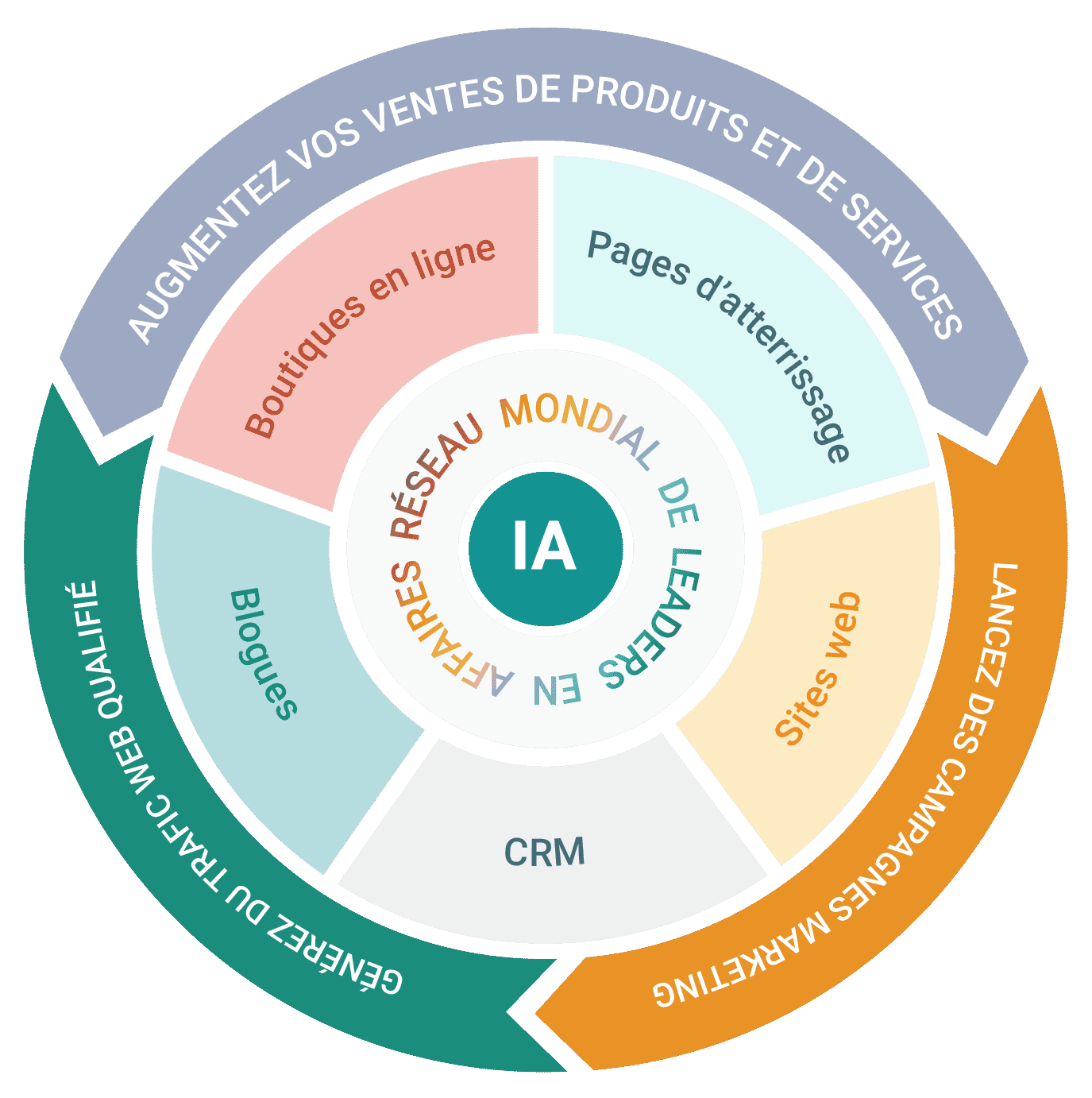« Je suis un peu en colère » : des entreprises canadiennes boycottent les produits américains
BBC
By Sam Gruet
17 March 2025
Trois mots qui sont désormais monnaie courante sur les étagères canadiennes, après que les tarifs douaniers de Donald Trump ont déclenché une guerre commerciale avec le voisin du nord des États-Unis.
Au Canada, les mesures économiques prises contre cette pratique ont été accueillies avec une vague de patriotisme, certains consommateurs et entreprises boycottant les produits américains.
D’autres entreprises ayant des activités aux États-Unis sont confrontées à un choix : surmonter l’incertitude ou rapatrier leur entreprise.
« En ce moment, je suis un peu en colère. Je ne veux pas investir dans des entreprises américaines », déclare Joanna Goodman, propriétaire d’Au Lit Fine Linens, une entreprise torontoise de literie et de vêtements de nuit.
« Il s’agit de mettre tous ses œufs dans le même panier. Et pour l’instant, ce panier est très risqué et très précaire », poursuit-elle.
Lors d’une visite dans l’un des deux magasins de son entreprise, installés dans un entrepôt géant, Mme Goodman met en valeur des lits élégamment faits, des mannequins en pyjama de soie et des étagères remplies de bougies parfumées, la plupart fabriquées au Canada.
Mais un cinquième du stock provient actuellement des États-Unis. Mme Goodman s’empresse de souligner : « Vous voyez la taille du magasin, donc même 20 %, c’est beaucoup. »
« J’ai un stock important de marques américaines avec lesquelles je collabore depuis 20 ans. Je ne vais pas le jeter », dit-elle. « La question est : vais-je en commander à nouveau ? »
Pour témoigner de l’engagement d’Au Lit Fine Linens envers les fabricants canadiens, ses magasins mettent désormais en valeur tous les articles fabriqués au Canada. Cette démarche se reflète sur son site web, qui propose une section « Achetez tout ce qui est fabriqué au Canada » et la mention « fabriqué ici, chez nous ».
Des attaques des Houthis en mer Rouge à la guerre en Ukraine, les événements mondiaux de ces dernières années ont donné naissance à un phénomène plus récent : la relocalisation.
Le rapatriement des activités commerciales sur les côtes nationales est l’inverse de la délocalisation.
Sandra Pupatello, chef d’entreprise et nouvelle membre récemment nommée au Sénat du Canada, affirme que la relocalisation est « vraiment évidente » à soutenir.
Pupatello, qui était auparavant ministre du Développement économique et du Commerce de l’Ontario, évoque la pandémie de Covid-19, lorsque les règles commerciales « ont été complètement abandonnées ».
Elle cite notamment l’exemple du fabricant américain de masques 3M, qui a subi des pressions de la Maison Blanche en 2020 pour cesser ses exportations vers le Canada et l’Amérique latine.
À ce moment-là, Pupatello pensa : « Nous devons nous préparer au pire ».
Peu de temps après, elle a créé Reshoring Canada, un groupe non partisan qui milite pour une chaîne d’approvisionnement plus résiliente au Canada.
Pupatello a déclaré à la BBC : « Si la situation se complique, le Canada sera livré à lui-même. Et si nous savons que c’est le cas, préparons-nous en conséquence. »

Les États-Unis ont imposé des droits de douane de 25 % sur l’aluminium et l’acier canadiens
Un rapport du gouvernement canadien de l’année dernière a révélé qu’il n’y avait « aucun signe de relocalisation à grande échelle ou d’augmentation notable des entreprises », mais les choses pourraient maintenant changer.
Ray Brougham tente de percer dans le secteur canadien de la construction automobile depuis la création de son entreprise Rainhouse Manufacturing Canada en 2001. Basée en Colombie-Britannique, elle fabrique des pièces pour un certain nombre d’industries.
Les chaînes d’approvisionnement intégrées de l’industrie automobile nord-américaine peuvent voir des pièces traverser les frontières entre les États-Unis, le Mexique et le Canada plusieurs fois avant qu’un véhicule ne soit finalement assemblé.
Le président américain Donald Trump a déclaré qu’il épargnerait temporairement aux constructeurs automobiles américains une nouvelle taxe d’importation de 25 % imposée au Canada et au Mexique, juste un jour après l’entrée en vigueur des tarifs douaniers en mars.
Mais dans le contexte d’une guerre commerciale, M. Brougham affirme avoir eu, pour la première fois, de « bonnes communications » avec une grande entreprise canadienne de pièces automobiles. « Soudain, ils sont intéressés à collaborer plus étroitement avec d’autres entreprises canadiennes. »
Pour M. Brougham et d’autres, les avantages de la relocalisation sont évidents : ils donnent un coup de pouce aux petites entreprises qui peinent à concurrencer les fabricants étrangers, garantissent des salaires équitables et offrent des avantages environnementaux liés à la réduction des importations et des exportations de marchandises.
D’autres, dont Graham Markham, directeur d’un fournisseur du secteur alimentaire, croient qu’il s’agit d’ajouter de la valeur aux produits que le Canada produit déjà.
Son entreprise canadienne New Protein International construit actuellement la première usine de fabrication de protéines de soja au Canada dans le sud-ouest de l’Ontario, à quelques kilomètres de la frontière américaine.
Le Canada est le quatrième exportateur mondial de cette culture, mais la majeure partie de celle-ci est transformée à l’étranger.
« Nous ne transformons pas ces ingrédients à valeur ajoutée en ingrédients de plus grande valeur ici, chez nous », explique M. Markham.
Des minéraux critiques à l’uranium en passant par le bois et le soja, il soutient que le moment est venu de changer.
Le Canada est depuis longtemps un fournisseur prospère de matières premières pour le monde entier. L’occasion est maintenant de cesser d’exporter les emplois et l’innovation qui découlent de la transformation de ces matières sur le marché intérieur.

Graham Markham affirme que le Canada devrait transformer davantage de ses matières premières
Le secteur manufacturier pourrait-il donc reprendre au Canada ? L’économiste Randall Bartlett affirme qu’il est trop tôt pour le dire.
« Il y a beaucoup plus de fumée que de feu lorsqu’il s’agit de réorganiser les chaînes d’approvisionnement et de les déplacer à l’échelle nationale », affirme M. Bartlett, directeur principal de l’économie canadienne chez Desjardins, basé au Québec.
« Je pense qu’il y a eu un mouvement vers la relocalisation, mais je pense qu’il y a beaucoup plus de discours autour de cela qu’il n’y a de véritable rétablissement des capacités de production. »
Il y a aussi des obstacles majeurs.
L’industrie automobile, par exemple, hautement intégrée, prendrait des années à déconstruire. Sa relocalisation nécessiterait « des dizaines de centaines de milliards de dollars d’investissements privés et publics », selon M. Bartlett.
Il y a aussi la réalité du commerce mondial.
« Certains pays sont plus aptes à produire certaines choses que d’autres », affirme M. Bartlett, suggérant qu’au lieu d’une poussée de relocalisation complète, la diversification des partenaires commerciaux du Canada pourrait être plus pratique.
Il affirme que le Canada devrait se concentrer sur « les secteurs où nous bénéficions d’un avantage comparatif », notamment les énergies renouvelables et la transformation de l’acier et de l’aluminium. Ces deux métaux sont désormais frappés d’un tarif douanier de 25 % s’ils sont exportés vers les États-Unis.
De retour chez Au Lit Fine Linens à Toronto, Joanna Goodman entre dans un vaste entrepôt, rempli du bruit des boîtes en carton en cours d’emballage.
« Nous expédions aux États-Unis des commandes passées avant l’entrée en vigueur des droits de douane », explique-t-elle avant de marquer une pause. « Nous avons reçu une commande le jour même de l’entrée en vigueur des droits de douane, et c’était une commande de très bonne taille. »
Elle dit ignorer si l’acheteur américain comprend que des droits de douane seront désormais appliqués. « Il doit demander à M. Trump [pourquoi] ».
Et la suite ? « Ces droits de douane pourraient disparaître d’un jour à l’autre. Attendons de voir comment la situation évolue, puis nous commencerons à prendre des décisions », déclare Mme Goodman.
Comme de nombreuses entreprises canadiennes, elle attend que la poussière retombe avant de décider où acheter, où vendre et ce que signifie réellement « Fabriqué au Canada » pour l’avenir.
Source: https://www.bbc.com/news/articles/cn7vjlv7pzdo